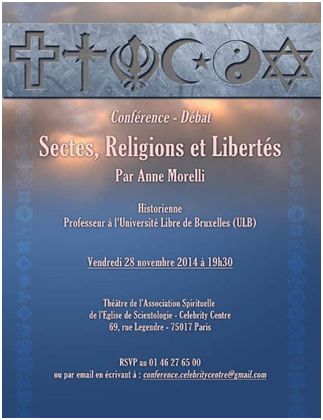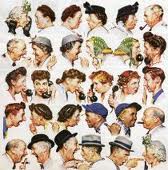Compte rendu de conférence
par Dominique Georges Luc MAGUIN
Anne MORELLI est connue au niveau international et spécialisée dans l’histoire des religions et des minorités. Elle fera un exposé, fruit de plusieurs années de recherches avec ses étudiants. Avant d’entreprendre ses travaux sur ce sujet, elle avait, selon ses propres dires, et comme quasiment la plupart des gens, des idées reçues sur la question. Au fur et à mesure de ses découvertes, son opinion a changé.
étudiants. Avant d’entreprendre ses travaux sur ce sujet, elle avait, selon ses propres dires, et comme quasiment la plupart des gens, des idées reçues sur la question. Au fur et à mesure de ses découvertes, son opinion a changé.
Par ses travaux sociologiques, Anne MORELLI démonte un à un tous les arguments qui cherchent à faire une distinction entre « bonnes » religions et « mauvaises » sectes, et anéantit les clichés habituels. Elle nous propose de comprendre l’émergence de nouvelles philosophies et spiritualités minoritaires, de les intégrer dans nos sociétés plutôt que de les juger et les discriminer.
« Sectes, Religions et Libertés »
Dans le milieu des années 90, alors que plusieurs affaires concernant des groupes religieux minoritaires étaient médiatisées, cette historienne, professeur d’université à Bruxelles, a lancé ses étudiants dans une enquête grandiose sur ces groupes.
L’objet de cette enquête : définir la ligne de démarcation entre « religion » et « secte ».
Initialement, l’idée sous-jacente, assez conventionnelle, était que l’on allait découvrir un ou plusieurs critères permettant de distinguer une « religion » d’une « secte ».
N.B. Anne Morelli nous a précisé que, dans son exposé, elle utiliserait le mot « secte », mais que, celui-ci étant évidemment péjoratif, il devrait toujours être compris comme étant écrit entre guillemets.
1er critère étudié : la dimension du groupe religieux
À Bruxelles, les Témoins de Jéhovah possèdent une vingtaine de salles de réunion.
Par contre, dans cette même ville, le judaïsme, « grande religion », ne dispose que d’un petit nombre de synagogues !
2e critère étudié : l’ancienneté.
Mais certaines religions vieilles de 3 ou 4 siècles (par exemple, les quakers) sont toujours qualifiées de « sectes » !
3e critère étudié : la dangerosité
Certaines religions minoritaires dévoient-elles les jeunes et les enfants ?
En fait, les enfants sont amenés à la religion par les parents, qu’il s’agisse d’une religion minoritaire, ou de l’Église catholique et du « catéchisme » !
Dans n’importe quelle communauté religieuse, les parents trouvent normal de transmettre leurs valeurs à leurs enfants !
Anne MORELLI elle-même, se revoit, photographiée en première communiante (catholique), vers l’âge de 10 ans !
Au contraire, dans toutes les communautés religieuses, et notamment dans celles qui sont minoritaires, il y a beaucoup de personnes âgées : celles-ci trouvent dans un petit groupe plus d’écoute et de chaleur humaine que dans le cadre d’une religion majoritaire.
Les religions se disent toutes « ouvertes à tous ».
Cependant, chaque communauté religieuse, en fonction de la religion, et aussi en fonction du quartier d’implantation, cible une classe sociale différente.
Ainsi, par exemple, selon Anne MORELLI, les Témoins de Jéhovah se recrutent souvent parmi les migrants d’origine chrétienne.
4e critère étudié : l’argent
Anne MORELLI donne plusieurs exemples d’ordres monastiques catholiques qui ont des activités commerciales profitant à leur communauté religieuse.
- Exemple de Padre Pio.
- Exemple de Sœur Sourire (Dominique, nique, nique !)
Cf. : https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%93ur_Sourire
Ayant quitté les ordres, elle tente une nouvelle carrière à partir de 1967 sous le nom de Luc Dominique, sans retrouver le succès de ses débuts. Poursuivie par l’administration fiscale belge, elle finit par se suicider en 1985.
Et, plus généralement, Anne MORELLI constate que, dans toutes les communautés religieuses, les membres donnent généreusement de l’argent… mais que, quelquefois, certains dirigeants sont malhonnêtes !
5e critère étudié : les mœurs
Certains imaginent qu’il y aurait, dans les groupes religieux minoritaires, une sexualité débridée.
En fait, selon Anne MORELLI, un groupe, un seul, pourrait justifier, au moins en partie, cette rumeur : celui des Enfants de Dieu.
Mais en fait, l’activité sexuelle – et ses « débordements » éventuels – est comparable dans les différents groupes religieux, quelles que soient leurs dimensions.
Certains groupes minoritaires sont même plutôt « puritains », comme les Témoins de Jéhovah.
6e critère étudié : le mode de vie « malsain »
Anne MORELLI évoque le mode de vie des moines catholiques Chartreux, soumis à des conditions de vie, d’interruption de sommeil, de prières fréquentes, etc… particulièrement sévères.
À comparer à certaines religions minoritaires comme les « Dévots de Krishna » ?
Anne MORELLI cite l’exemple de sa grand-mère, catholique, disant son chapelet, et répétant des dizaines de fois : « Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous ! ».
Cf. « Hare Krishna » ?
7e critère étudié : comment sortir de religion ?
Anne MORELLI a eu trois tantes religieuses, dont une est entrée dans l’Ordre de la Visitation à 18 ans. Impossible pour elle de le quitter !
8e critère étudié : la conversion
Pour Saint Paul ou Constantin, on raconte leur conversion « instantanée » au christianisme, et on trouve cela très bien.
Mais si quelqu’un entre aujourd’hui dans une religion minoritaire, ses proches disent : « On lui a fait un lavage de cerveau ! ».
En fait, toute conversion est le résultat d’un cheminement personnel, quelle que soit la religion à laquelle on se convertit.
9e critère étudié : comment une religion règle les détails de la vie intime des personnes
La religion intervient dans le mariage, et, plus généralement, dans la sexualité des personnes, aussi bien dans une religion majoritaire que minoritaire.
- Interdiction catholique des relations sexuelles avant le mariage, de la masturbation, de l’adultère, de l’avortement, de l’homosexualité, etc.
- Célibat des prêtres.
- Prêtrise réservée aux hommes.
- Omniprésence des cloches pour obliger les gens à pratiquer.
- Signe de croix.
10e critère étudié : croyances : rationnelles ou irrationnelles ?
Transsubstantiation (catholicisme).
Virginité de Marie, même après accouchement (catholicisme).
Conclusion d’Anne MORELLI
Concernant la recherche universitaire initiale, les résultats trouvés étaient inattendus !
- Deux poids, deux mesures.
- C’est l’État qui distribue les « labels ». Mais entre « religion » et « secte », la ligne de démarcation est une ligne imaginaire, comme l’Équateur !
- Le contenu de l’une comme de l’autre est le même.
- L’État favorise la religion qu’il veut, et cherche à détruire les autres par l’appellation de « secte ».